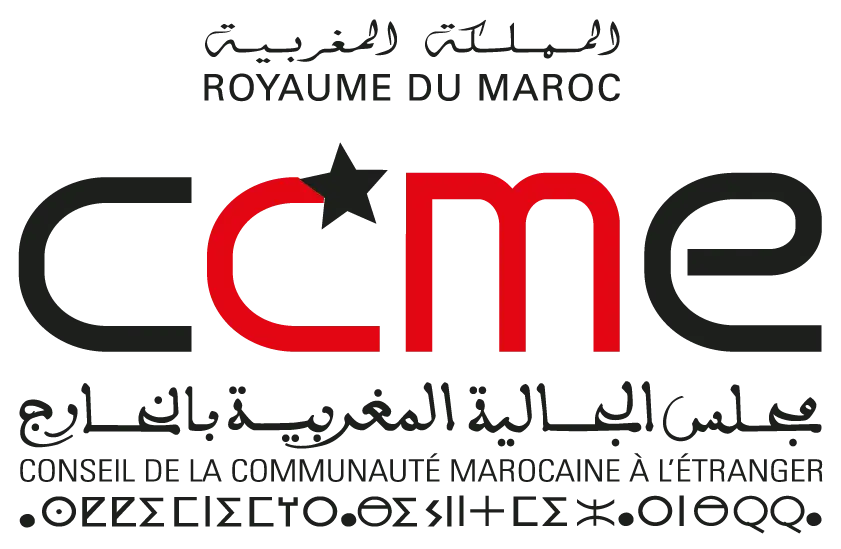Sanjay Subrahmanyam, grand spécialiste indien de l’histoire « connectée », qui met en regard les points de vue occidentaux et orientaux, a rejoint le Collège de France à la chaire d' »histoire globale de la première modernité ». Il fait le constat d’une « chute » progressive de la France sur les plans culturel et diplomatique, et s’inquiète de la montée de l’extrême droite et d’une hostilité croissante des Français vis-à-vis des étrangers.
Que signifie être étranger dans la France d’aujourd’hui ?
Il faut évidemment distinguer plusieurs sortes d’étrangers. En France, quand on pense à un étranger, c’est d’abord à un Maghrébin ou à un Africain. Un jour viendra peut-être où l’on parlera davantage des Indiens et des Bangladais. Une personne comme moi, originaire du sous-continent indien, passe un peu inaperçue en France, et n’est pas stéréotypée à la manière d’autres types d’étrangers. Cela a des avantages, mais cela engendre aussi des confusions, par exemple si l’on me prend pour un immigré de Pondichéry, qui faisait partie de l’empire colonial français. Cela m’est arrivé au Portugal : être assimilé à un Goanais parce que je suis lusophone.
J’ai travaillé en France pendant sept ou huit ans et, quand j’en suis parti, on m’a traité d’apostat ou de renégat, car je ne manifestais pas une loyauté suffisante envers les institutions françaises ! Mais ces appartenances multiples et ces façons diverses de percevoir quelqu’un sont réelles : on peut me percevoir par le biais de ma profession, de mes origines ou, de façon moins fine, comme un taliban barbu.
A l’ère de la mondialisation, quelle place occupe la France sur le plan intellectuel et international ? Est-elle irrémédiablement condamnée à n’être qu’une puissance moyenne ?
Depuis vingt ans, le changement politique n’a pas été si flagrant. Si changement il y a eu, c’est plutôt pendant les sept ou huit premières décennies du XXe siècle : entre la France de 1914 et celle des années 1980. En ce qui concerne la notion de pouvoir, la perte de l’empire colonial a impliqué un certain nombre de choses ; mais il faut aussi parler – ce qui est peut-être plus compliqué – de la perte du poids culturel. En 1980, cette chute n’était pas évidente, puisqu’on parlait de la « French theory » dans les universités américaines. Philosophes et sociologues français étaient influents : Michel Foucault, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu.
Aujourd’hui, ces figures ont disparu sans avoir été remplacées. C’est une perte de vitesse, même s’il est trop tôt pour affirmer que c’est un tournant décisif. Il y a une espèce de perte progressive du français comme véhicule de communication intellectuel et international. C’est bien dommage. De nos jours, il y a trois langues qui pèsent inégalement sur l’échelle internationale : l’anglais, le chinois et l’espagnol.
Une histoire japonaise met en scène un samouraï appauvri qui marche dans la rue en arborant un énorme cure-dent pour montrer à quel point il a bien mangé. On a parfois la même impression avec la France. Un exemple : les salaires dans l’enseignement supérieur public sont très inférieurs à ce qui se pratique aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Et pourtant, on n’en cherche pas moins à attirer des professeurs étrangers. Comment croit-on y parvenir ? En jouant du prestige français, notamment dans le domaine culturel ? Ce n’est pas si simple. Dans le secteur privé, on a compris que le marché existait, et que si l’on veut faire venir quelqu’un chez L’Oréal ou Alcatel, cela a un prix : lui payer l’équivalent de ce qu’il pourrait obtenir ailleurs dans le monde. Mais les instances publiques ne l’ont pas encore compris.
Et sur le plan du rôle de la France dans le monde ?
Sur le plan international, depuis l’époque du général de Gaulle, les Français ont toujours voulu jouer le rôle de contrepoids. Telle est la logique qui a présidé au choix d’être une puissance nucléaire, alors qu’il y avait assez de bombes dans le monde. La question se pose encore, même dans le cas de la Syrie. Mais les Français se trouvent dans une certaine difficulté. Ont-ils vraiment le champ libre ? Dans le cas libyen, ils ont poussé un peu en avant. Quoi qu’il en soit, cette notion d’autonomie d’action telle qu’elle a pu avoir cours dans les années 1950-1960 a perdu de sa force.
Estimez-vous que la France a toujours du mal à assumer son passé, surtout son passé colonial ?
Est-ce que la France a plus de difficulté à assumer son passé colonial que les autres ex-puissances impériales ? Qui parle, aux Etats-Unis, de ce qui s’est passé aux Philippines aux XIXe et XXe siècles ? Personne, pas plus que l’on n’a assumé la guerre du Vietnam dans ce pays.
La comparaison doit se faire aussi avec l’Angleterre : d’un côté, les Anglais ont mieux digéré leur passé colonial ; mais de l’autre, les Français ont une attitude moins dure envers les populations issues de leur ex-empire colonial. Le niveau de racisme que j’ai ressenti en Angleterre envers les Indiens et les Pakistanais est bien supérieur à ce qu’on vit avec les Maghrébins en France. Dans bien des milieux en Angleterre, on n’a aucune idée de ce qui s’est passé dans les colonies, et on croit parfois qu’il s’agissait simplement d’une belle aventure.
La vraie question est de savoir comment on enseigne ce passé. On peut très bien s’inscrire en licence d’histoire à l’université et passer à côté de l’histoire coloniale. Mais au sein même de l’histoire de la colonisation, on parle beaucoup moins de l’Indochine et de l’Afrique noire que de l’Afrique du Nord. Le Liban et la Syrie sont, du reste, très peu évoqués. Pourtant, l’influence française dans le Machrek a aussi laissé des traces. Après la première guerre mondiale, la France a joué un rôle considérable au Moyen-Orient. Mais est-on prêt à assumer ce passé-là ? Par exemple, l’origine du parti Baas [Irak, Syrie] doit beaucoup à des individus sous influence française.
En Europe – mais aussi aux Etats-Unis et même en Inde –, on a l’impression qu’aux yeux de certains, l’islam et l’islamisme ont remplacé le communisme dans le rôle d’ennemi. Qu’en pensez-vous ?
La question est surtout de savoir s’il y a un consensus intellectuel autour de la confusion entretenue, en France, entre islam et islamisme. Ce qui est clair, c’est que les discours qui étaient jadis propres à l’extrême droite se sont banalisés. Pour parodier la phrase de Jean-Marie Le Pen, tout le monde dit désormais tout haut ce qu’il pensait tout bas. En Inde, ce qui distingue le parti hindouiste de droite du Parti du Congrès, c’est l’attitude envers l’islam. Aux Etats-Unis, le Tea Party est certes empreint d’islamophobie, mais, lorsque l’on entend les remarques des élus démocrates et républicains sur l’islam, on se dit qu’il est bien difficile de les distinguer. Ces idées extrêmes ont gagné du terrain, tout en s’accompagnant d’une ignorance de l’islam. Un responsable américain avait même été jusqu’à se réjouir que la guerre ait lieu en Irak en 2003, car, selon lui, il n’y avait pas de lieu saint musulman dans ce pays [ce qui est faux : les principaux lieux saints du chiisme, Nadjaf et Kerbala, sont situés sur le territoire irakien]. Vous imaginez, partir en guerre contre un pays dont on ignore le b.a.-ba !
Trouvez-vous que les élites françaises, contrairement aux élites américaines, sont trop homogènes et ne laissent guère de place à la diversité ?
Le cas des Etats-Unis est très différent de celui de la France. Le doyen de mon université, UCLA (Californie), est un Italien qui parle l’anglais avec un très fort accent. Cela n’a en rien empêché son accession à un poste important dans l’administration. L’équivalent serait difficile à concevoir en France. Peut-on devenir recteur d’université à Paris avec un fort accent argentin ? Des efforts ont toutefois été fournis. Ce que Richard Descoings [ancien directeur de Sciences Po, mort en 2012] a entrepris en ouvrant l’institution [recrutement dans les zones d’éducation prioritaires et à l’étranger] était encourageant. Il est intéressant de voir que cette initiative a fait l’objet d’une opposition peu affichée mais sensible.
Au niveau des personnalités publiques, lorsque quelqu’un de « différent » est recruté, c’est comme si c’était un petit cadeau. Comme si c’était fait pour pouvoir dire : « Moi, j’ai un Africain dans mon cabinet. » On ne donne pas l’impression que cette place a été méritée. Je me demande quelle conséquence psychologique cela produit sur le bénéficiaire : se demande-t-il chaque jour s’il est là parce qu’il le mérite ou s’il est là pour faire plaisir aux personnes de couleur ?
On dit l’Europe en déclin par rapport aux puissances émergentes. D’un autre côté, lors des « printemps arabes », on a pu penser que les valeurs dites « occidentales » étaient revendiquées dans le monde entier. Que pensez-vous de cette contradiction ?
L’Europe est-elle en train de se « provincialiser » ? Politiquement, cela fait longtemps que ce processus a commencé. Français et Britanniques ont pu entretenir des illusions, mais, dès les années 1960, les jeux étaient faits. Et sur le plan culturel ? Paradoxalement, je crois que les idées de gauche comme de droite qui se répandent dans le monde viennent le plus souvent de l’axe transatlantique. Ce que je trouve problématique, c’est qu’à chaque fois que l’on découvre des idées plus ou moins fascisantes dans le monde, des Occidentaux s’empressent de dire que cela ne vient pas d’eux. Comme si seules les Lumières venaient d’Occident ! La réalité est qu’il y a eu des admirateurs de Benito Mussolini (et un peu d’Adolf Hitler) dans le monde extraeuropéen. Pour nous, c’était ça aussi, l’Occident ! On ne peut pas décider que seul ce qui est démocratique et positif vient d’Occident, et rejeter le reste de l’héritage, en prétendant que c’est la différence culturelle qui l’a créé.
France, terre des droits de l’homme et en même temps, pays où l’extrême droite ne cesse de se renforcer. Que vous inspire cette contradiction ?
De l’inquiétude. Quand on arpente les rues de n’importe quelle ville française, on se prend à penser que si un Français sur six a voté pour un parti d’extrême droite, cela fait beaucoup de monde, même si ce n’est pas affiché sur les visages des gens. Il est inquiétant de voir une minorité estimer que les personnes de couleur n’ont pas vraiment le droit d’être là, et qu’elles devraient plutôt rentrer « chez elles ». Je l’ai vécu moi-même, pas tant en France qu’en Angleterre, où l’on m’a craché au visage en pleine rue. A Oxford, un jour, tandis que je marchais avec ma femme, une Américaine, je me suis fait traiter de « salopard d’imam ».
Si la France est une terre d’asile, c’est un idéal. Mais quelle est la réalité ? J’ai vu dans l’Eurostar des personnes menottées que l’on expulsait d’Angleterre pour être renvoyées, non pas en France, mais ailleurs.
L’histoire est considérée, en France, comme une discipline reine et, pourtant, elle souffre d’une désaffection de la part des étudiants. La discipline, chargée autrefois de façonner l’identité nationale, a-t-elle perdu de son importance ?
Pour certains, les historiens qui font de l’histoire connectée auraient semé la confusion, et seraient à l’origine de la désaffection pour la discipline. C’est faux et malintentionné. Il faut se résigner à l’idée que l’on ne peut plus enseigner l’histoire aujourd’hui comme en 1960 ! Je pense que, si l’on enseigne à nos étudiants un monde qui ressemble plus à celui qui les entoure, on a plus de chances de les intéresser qu’en leur parlant d’une France dorée qui n’a jamais existé. On m’a dit qu’on allait donner plus d’importance au monde ibérique dans les études d’histoire. Il était temps que l’université française s’en aperçoive ! On peut beaucoup reprocher aux Etats-Unis, mais il y prévaut aussi cette idée qu’il faut dépasser le cadre étroit de l’histoire nationale.
Quelle est la place de l’intellectuel public à l’ère de la mondialisation ?
Il y a un certain type d’intellectuels publics qui écrivent un style d’histoire au service du pouvoir. Au moment de la guerre d’Irak, il s’est ainsi trouvé des historiens américains et anglais pour écrire que le destin des Etats-Unis est de reprendre le flambeau de l’Empire britannique, le « fardeau de l’homme blanc ». Dans le cas français, certains intellectuels semblent un peu trop pressés de prôner une invasion ici ou là. Les spécialistes des relations internationales ou de sciences politiques sont souvent plus proches du pouvoir que les historiens. Si l’historien flatte le pouvoir, c’est triste. Il ne faut pas abuser de l’histoire pour faire ce qu’on voulait faire de toute façon. Si nous, les historiens, servons à quelque chose, comme le dit Carlo Ginzburg, c’est toujours en se faisant les avocats du diable.
quelqu’un sont réelles : on peut me percevoir par le biais de ma profession, …
07.09.2013 , Gaïdz Minassian et Nicolas Weill
Source : LE MONDE